Nous voterons le 18 juin, en plus de la loi climat (votez un grand oui !), sur l’inscription dans la Constitution genevoise d’un droit à l’intégrité numérique. Une proposition qualifiée ici ou là de pionnière.
Assurément, ce nouvel article constitutionnel serait pionnier. La question est en effet sur toutes les lèvres, dans d’autres cantons et au niveau de la Confédération, où le socialiste Samuel Bendahan a justement proposé une démarche similaire (dans une version néanmoins beaucoup plus épurée et “élégante”).
Je voterai assurément oui, mais pas sans une petite hésitation, à ce nouvel article. Il convient en effet de tempérer les ardeurs de celles et ceux qui se rengorgent de cette nouveauté genevoise, de nature avant tout déclamatoire et qui risque de nous bercer d’illusions sur le fait d’avoir traité cet enjeu fondamental de manière efficace et pertinente.
En effet, il est nécessaire de bien comprendre ce qu’est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Ces droits visent avant tout la protection des individus face à l’Etat. Et n’induisent en rien de manière directe une protection contre la mainmise des GAFA, comme on a pu l’entendre, soit les géants du numérique comme Google Apple, Facebook (devenu Meta) et Amazon, ou plein d’autres “ogres” qui consomment et utilisent nos données privées de manière incontrôlée et vorace. La situation est similaire avec le droit au logement, qui figure dans notre Constitution (ou bientôt le droit à l’alimentation, si le oui l’emporte le 18 juin, comme on peut l’espérer): vous ne pourrez pas vous référer directement à de tels droits pour intenter une action en justice à l’encontre d’un propriétaire afin d’exiger un logement décent ou envers les grands distributeurs afin d’obtenir une alimentation saine et suffisante.
On peut aussi questionner, comme l’ont fait Michael Montavon et Livio Di Tria dans cet excellent article sur le site Swissprivacy.law, le fourre-tout qu’on met dans cet article constitutionnel. Les auteurs de cet article montrent d’ailleurs bien que l’essentiel de ce que contient l’article figure en réalité déjà dans des dispositions constitutionnelles existantes. S’il est légitime d’ancrer plus fortement l’idée que l’Etat (au sens large du terme) n’a pas à stocker inutilement des données et doit être transparent et éthique sur leur usage, je regrette que cette proposition portée principalement par la droite économique, donne l’impression d’évacuer le débat tout aussi essentiel sur l’usage marchand excessif de nos données par des acteurs privés. Louis Viladent en fait d’ailleurs très bien traité dans son article paru dans le Courrier du 10 juin 2023.
En revenant à l’exemple du droit au logement dans notre Constitution, on constate que pour devenir effectif, il s’agit pour l’Etat de concrétiser le nouvel article constitutionnel dans la loi. Le droit au logement, comme celui de la priorité à la mobilité douce approuvée en mai 2011, n’ont pas vraiment été mis en œuvre. Il faut des lois d’application qui font ensuite l’objet d’une jurisprudence claire et, bien sûr, une société civile active, si veut que des droits constitutionnels s’appliquent. Actuellement, les autorités cantonales disposeraient déjà du cadre constitutionnel pour agir de manière plus engagée face à l’accaparement des données, à la protection de la vie privée, etc.
Gageons que la conjonction d’une votation populaire gagnée et surtout l’arrivée de la Conseillère d’Etat Carole-Anne Kast à la tête du numérique de l’Etat, permettront de donner une nouvelle impulsion pour un numérique plus responsable, inclusif et durable !











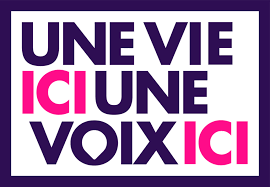
ajouter un commentaire